Très peu de temps pour vivre intensément
- Thibault Randoin
- Jun 22, 2023
- 6 min read
Ce titre, qui pourrait être la mise en garde d’un homme au crépuscule de sa vie, peut aussi être un mantra, sinon une prédiction, du moins un sentiment. Celui un peu puéril d’un garçon de trente deux ans qui n’a pas la patience d’attendre que son existence s’épaississe par l'infusion du temps et qui tente d’y remédier par ses actes. Et bien cette pensée peut, ou plutôt doit s’inscrire dans un programme beaucoup plus vaste que le simple fait de s'élancer dans une courte marche au sein d’un monde rural, à peine sauvage. Voyez plutôt l’initiative suivante comme le symptôme d’une maladie, peut être vertueuse, que je nomme, faute de termes latins: “l’urgence de vivre”.
Je suis parti car j’en avais assez de l’immobilité. Je suis parti sans rien attendre de ce séjour, à part, peut-être, avec cette envie de distordre le temps, de le ralentir pour que ces deux pauvres jours de disponibilité en paraissent le double. Et puis je caressais aussi un peu l’espoir que marcher seul dans la nature aurait cet effet quasi psychotrope : se sentir libre, défait de toutes responsabilités, n’être qu’un corps sur la terre qui n’est là que pour se fondre dans son milieu.
J’ai hésité pendant les trois jours précédant le départ car la météo était instable, ce que ma condition d’homme moderne n’accepte pas. Il faut un ciel d’azur et un horizon cristallin pour s’assurer le confort. Mais combien de fois ai-je souqué dans le vent en en gardant de fabuleux souvenirs ! La prévision météorologique n'est-elle pas un frein à l’épopée?
Et puis j’étais seul, ce que je souhaitais, car la solitude c’est parfois la liberté, mais c’est aussi n’avoir personne pour lancer le “On y va !” qui déclenche le mouvement.
Et enfin je ne savais que faire. J’ai failli en appeler à la mécanique pour couvrir plus de distance mais le vélo semblait être trop exposé au froid de la saison.
Je me suis donc résolu à partir marcher car quand rien d’autre ne semble adéquat, il reste toujours cette vieille technique assez démodée, voire carrément d’un autre temps, mais qui a fait ses preuves: avancer un pied, puis l’autre et recommencer.
J’avais la manière, il restait à choisir le lieu. Mon goût pour la steppe, pour le plateau et pour la douce ondulation paraissait être un mauvais choix compte tenu du vent annoncé. Il restait à faire ce que font les animaux, se replier dans les arbres, gagner la forêt comme on gagne un abri.
Je partais de Ruyne en Margeride en direction du mont Mouchet, cette espèce de vague hérissée d'épicéas qui occupe largement son socle: la Margeride. Au départ, il faut quitter le bourg animé du marché dominical pour entamer la lente montée, d’abord entre les prés et le long de ces vieux corps de ferme. Lorsque les hameaux seront définitivement désertés, il n’en restera que les corps.
Puis vient la forêt. À l’entrée de celle-ci un panneau: “ Interdit sauf autorisation”. Je me dis qu’il y a des sociétés comme celles-ci. D’autres pourraient afficher : “Autorisé sauf interdiction”. Il s’agirait alors d’un état permissif, ce serait le Far West, les État-Unis en 1800, chacun serait chez-soit là où il s’installe, cela finirait en bain de sang, en guerre civile, et finalement en interdictions. Alors finalement l’autorisation dans l’interdiction donne un sentiment de privilège et n’est-ce pas gratifiant d’être privilégié ? Et puis il y a la dernière catégorie de société, celle pour laquelle rien ne serait inscrit, pas de panneau, liberté absolue dans le flou de l’incertitude ou bien interdiction induite, fruit de la grande répression, de celles qui inculquent la soumission sans borne, merci Orwell pour l’idée. D’ailleurs, en Chine, lorsqu’un débat fait rage en société, est-ce qu’un des protagonistes lance: “ Votons, on est en démocratie merde !” ?
J’ai donc pénétré la sylve sans autorisation mais il semblerait que les piétons ne soient pas concernés. En revanche, les véhicules autorisés doivent vraisemblablement remplir quelques prérequis, le premier étant d’abattre un maximum d’arbres. Le deuxième : faire des tranchées les plus grosses possibles en laissant derrière eux des coupes rases. Le but ? Peut être reconstituer la bataille de Verdun. Souci du détail historique. Ou bien faire du profit en raclant son avenir comme le sol : jusqu'à l'os. Avant, lorsque le bûcheron entrait dans la forêt avec sa hache, les arbres se rassuraient: “ Courage, le manche est des nôtres ” disaient-ils. Aujourd’hui, leur seul soulagement est que l'abattage est rapide.
Je réfléchissais à tout cela en montant tranquillement puis je débouchai au sommet de cette croupe dégagée, herbeuse, que je remontais alternant entre forêt et parterres de myrtilles. Un panneau m'apprit que ce vent froid du nord qui me cingle se nomme l’Écir.
“Voulez vous bien vous abstenir de souffler si fort m’Écir” dis-je. Mes mots sont partis dans le vent.
Je fini par arriver au pied du mont Mouchet où se trouve un monument aux morts. Le vent avait plié le drapeau français de telle sorte que l’on eût dit celui de la Russie, flottant là, à côté de cette immense construction grise, en béton, rectangulaire, soviétique. Un buste de Staline en son sommet aurait définitivement complété l’illusion et j’aurais tendu l’oreille pour guetter le Transsibérien dans la taïga. Je poursuivi quelques kilomètres avec, dans un coin de la tête, cette idée que croiser des moujiks ou des ours est possible mais je ne suis pas assez à l’Est sur le continent pour que cela soit vrai, et lorsque j’arrive à la table d’orientation ce n’est pas le Baïkal que je vois mais le lac de Langogne. Je pose mon bivouac.
La nuit, le vent et le froid se sont ligués contre moi. Au réveil, les arbres sont figés dans le givre, l’Écir est toujours là, les nuages défilent, ils glissent sur la crête pareil à des fantômes fous et s'éclatent dans les arbres, éventrés par les branches crochues des pins. Ce maudit vent ne tarira guère, je quitterai la montagne le laissant seul dans sa colère. Je ne fut pas à son chevet pour recueillir son dernier souffle.
Après huit kilomètres je coupe une route principale, j’ai froid alors que tous mes vêtements sont sur mon dos, je suis humide, je doute. Je consulte la carte, je me trouve à vingt deux kilomètres de la voiture par une route nationale et je suis sûr que je trouverais une âme charitable pour me prendre en stop et me ramener. Je pars en direction de l’abandon, fais cinquante mètres sur la route, je cogite, et finalement me ravise. J’avais prévu d’aller jusqu’au Malzieu, à quinze kilomètres de là, je ne voulais pas faire une boucle, je vais poursuivre jusqu’au bout. Je sillonne les chemins creux sous les frondaisons des chênes et parcourt lentement les grandes pistes forestières entre les conifères. Parfois je m’arrête, je pose le sac. Je ferme les yeux, le chant des oiseaux me berce, je m’endors et me réveille sans savoir combien de temps je suis resté assoupi car celui-ci n’a plus d’importance, il ne compte plus, il est dissout, il n’y a plus d'échelle qui tienne, ni de temps ni de distance, plus rien n’a d’importance si ce n’est d’être à l'affût de tous ses sens pour emmagasiner la nature comme une jouvence, le voyage fonctionne, la thérapie agit. C’est le froid qui me fait repartir, m’activer pour raviver la seule source de chaleur dont je dispose: mon corps.
Je fini par arriver dans ce village qui marque la fin du voyage. Personne. Pas même une boulangerie ou un bar pour me réconforter. Cette fois, je cherche à faire du stop. Cette fois j’ai le droit, je rentre, j’y parviens, il y a des gens qui n’ont pas peur d’aider les âmes esseulées sur le bord des routes. Assis dans la benne d’un pick-up voyant défiler le paysage à l’envers je tire les conclusions du voyage. Pendant deux jours j’ai réfléchi et j’ai pensé. J’ai usé de ce phénomène étrange de corrélation entre le mouvement des jambes et le moulinement du cerveau. Grâce à ces rouages qui semblent fonctionner ensembles, grâce au rythme parfait de la marche, grâce aux bruits de la forêt, grâce à l'engrènement du décor qui change discrètement il s’est passé quelque chose sous la capuche, un léger frémissement, “une très légère oscillation” comme le dit si bien Tesson. Mon feu intérieur a brûlé, reste la cendre du souvenir, et quelques braises à raviver pour les prochains voyages.











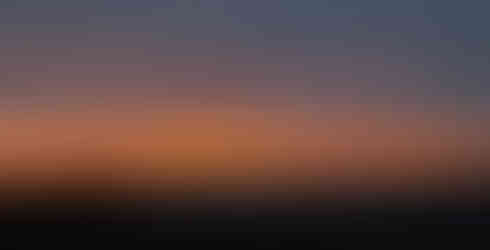



En Albanie, vous pouvez trouver la GPA (gestation pour autrui ou maternité de substitution) via des cliniques et des agences spécialisées dans les services de reproduction. La législation albanaise ne réglemente pas encore strictement cette pratique, ce qui rend le pays attractif pour la clientèle internationale. Vous pouvez vous référer à des articles et blogs sur le processus et les aspects juridiques du GPA en Albanie, par exemple sur le site https://uamedtoursfr.com/blog/article/la-gestation-pour-autrui-en-albanie, qui décrit dans détailler les caractéristiques du programme, les exigences, les coûts et les conditions pour les futurs parents.
Bonjour! Pouvez-vous s'il vous plaît me dire où je peux trouver des services de maternité de substitution (GPA) en Albanie? Je suis intéressé par des informations sur les cliniques ou les agences qui fournissent de tels services, ainsi que sur les conditions et exigences pour les participants au programme. Je voudrais savoir quels aspects juridiques doivent être pris en compte et où je peux obtenir des conseils détaillés sur cette question. Je serais reconnaissant pour les recommandations de ressources fiables ou de contacts de spécialistes dans ce domaine.