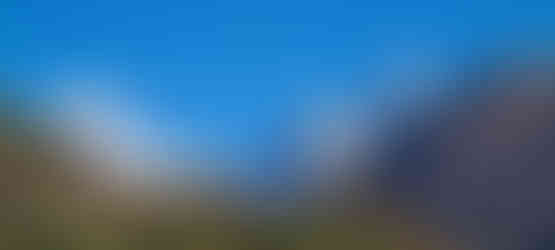Namasté
- Thibault Randoin
- Feb 8, 2024
- 21 min read
“Namasté” . Voilà comment commencent tous les mauvais récits sur le Népal. Pourquoi le mien dérogerait-il à cette règle? Et puis c’est bien Namasté. Cela permet de dire bonjour ce qui est particulièrement adapté au début d’un récit. Pourquoi chercher un incipit grandiloquent quand il suffit de dire bonjour? C'est aussi le mot népalais que nous avons le plus utilisé pendant un mois. Le seul même. Il faut dire que nous n’en connaissions pas d'autres. Et c’est un mot qui sonne bien. Il y en a quelques-uns comme cela que j’aime particulièrement. Pour leurs sonorités souvent, pour ce qu’ils représentent parfois. Steppe par exemple. J’aime le son et j’aime le lieu, nous n’en rencontrerons pas. Bivouac aussi, synonyme de liberté, froid en ce qui nous concerne. Tsampa bien sûr. On dirait le nom d’une danse latine. Mais je préfère sa mélodie à son goût. Avant de connaître la fameuse farine d’orge grillée nommée tsampa qui est la nourriture de base des sherpas et que tous les grands voyageurs qui arpentent l’himalaya évoquent dans leurs récits, il fallait atteindre la capitale, Katmandou. Nous partions au Népal. Pour voir les grandes montagnes il fallait un grand voyage, c’était un mois. Comme il est chic d’être au soleil quand la France est sous la grisaille, c’était en novembre.
Nous venions de récupérer nos gros sacs à dos, ils nous angoissaient. Ils faisaient vingt bons kilos et tout n’était pas encore à l'intérieur. Nous les aurions volontiers laissés défiler sur le tapis roulant de l'aéroport mais nous avions prêté un serment: “ ce dont tu auras besoin tu le porteras”. La chasse aux kilos était ouverte. Malgré tout, il nous fallait beaucoup de matériel. Pour bivouaquer, pour l’alpinisme, pour le froid. Pour nous laver, nettement moins. Dans un pays de sherpas, nous voulions tout porter nous-mêmes. C’était probablement aussi saugrenu que de cuisiner quand on va au restaurant mais c’était notre choix. Le choix de la liberté, de l’adaptation, de l’économie, définition de la légèreté d’esprit. Nous étions chargés mais légers dans nos têtes. Nous voyagerions à notre rythme. Nous étions toujours à l'aéroport et déjà les bretelles nous sciaient les épaules, il fallait encore obtenir son visa, changer l’argent, prendre un taxi et découvrir la cohue sur la route, trouver cela incroyable. Débarquer dans Thamel, trouver cela incroyable. Prendre une douche après ce long voyage, trouver cela incroyable. Dormir 12 heures d'affilée, trouver cela incroyable. Au petit déjeuner, dans le calme d’une cour intérieure, avec un thé massala fumant dans la main, une omelette dans l’assiette, nous trouvions toujours cela incroyable que tout se soit si bien déroulé. Nous attendions un homme contacté par internet quelques jours avant, il devait venir à 10h pour que nous lui fournissions tous les documents nécessaires à l’obtention de nos permis d’ascension. Il était là cinq minutes avant l’heure du rendez-vous, nous lui donnions ce qu’il fallait et notamment la moitié de notre richesse en espèces. En échange nous avions sa parole que le lendemain à la même heure il serait assis au même endroit avec nos permis. Ce fut le cas, avec la certitude désormais que nous pouvions partir ou nous le souhaitions sans guide et sans porteur et devinez quoi, nous trouvions vraiment cela incroyable. Quant au concept de permis pour grimper, nous faisions avec mais sans bien en connaître l’utilité. Financière? Certaine pour l’état. Sécuritaire ? Peut-être sur les grands sommets afin de limiter la fréquentation. Pour nous? Abusive. En France, les permis pourraient être des obligations, non pas à gravir car la solitude des montagnes est trop précieuse, mais à faire des tours de piste au pas de course pour endiguer le mal national : la sédentarité. Le slogan de l'État: “Mangez, bougez”. Cela veut dire qu’il faut manger avant de bouger. La récompense avant le mérite en somme. Il y a donc un problème de sens mais il manque aussi une précision dans l’injonction du gouvernement, celle du rapport d’équilibre. Inspiré par celui du budget de la sécurité sociale, la norme semble être “Mangez beaucoup, bougez peu” mais attention, “Prenez soin de vous” dit le médecin. Peut-être qu’en prenant un peu moins soin de nous, nous irions un peu mieux. Pour le mois à venir, notre méthode serait de prendre soin de nous en bougeant beaucoup et en mangeant peu, mais avec la permission du gouvernement Népalais.
Ces deux jours à Katmandou furent doux. Nous errions dans la ville. Le premier jour, comme le font tous les touristes leurs premiers jours, nous sommes allés à Monkey Temple, autant pour voir le lieu que pour les singes en liberté. Ces petits primates peuplent la forêt à flanc de colline dont le sommet est un temple d’un blanc immaculé entouré de moulins à prière. Il faut toujours tourner autour des moulins à prières dans le sens des aiguilles d’une montre au risque de se faire mal voir par quelques divinités hindouistes. De plus, il faudrait être stupide ou croisé avec un saumon pour remonter le flot de personnes tournant toutes dans le même sens. Nous avons fini par le comprendre après la moitié du tour à contre-sens…
Après cela nous avons cherché un sommet en périphérie ou nous avons pu admirer la ville d’en haut et sortir de cet océan de bruit, d’odeurs rances et de rébellion face au code de la route. Il faut quelques jours à nos cœurs d’occidentaux pour ne plus réagir devant les vitrines des poissonniers bondées de mouches, pour ignorer les gamines mendiantes qui ne vous lâchent pas où pour ne plus détourner le regard devant l’alignement des têtes de chèvres brûlées au chalumeau qui fixent les autres chèvres attachées devant l'échoppe. Ignorent-elles encore le sort qui leur est réservé? Mais bon dieu que font-ils avec cela ? Nous sommes retournés dans Thamel, ce vieux quartier commerçant car la vue des contrefaçons de doudounes North Face nous était plus agréable.
Il était 5h30 du matin lorsque nous prenions place dans le bus qui devait nous extirper lentement de Katmandou. Quinze minutes plus tard, nous démarrions. La moitié des places étaient encore vacantes, nous pensions que nous ferions le voyage comme ça. Nous étions bien candides. La durée de ce transport devait être de 9 heures, pour faire à peine 200 kilomètres. Après quelques tours de roues, nous avions compris la manœuvre. Le chauffeur roulait le plus vite possible, et un autre homme, accroché à la porte latérale, criait une volée de mots dont nous ne comprenions pas encore le sens à destination des gens amassés sur le côté de la route. Parfois, souvent même, il s’agissait de s'arrêter le plus vite possible, de charger les voyageurs, puis de redémarrer en trombe. Au fil des kilomètres et à force de l’entendre, nous avons fini par discerner les mots du rabatteur: “ Tsingati, Charikot, Chetchet”. L’homme jetait à qui voulait l’entendre le nom des trois villes principales que nous allions traverser. Le dernier, Chetchet étant un minuscule village de quelques bicoques au bout d’une piste cahoteuse, c’était le terminus mais nous en étions encore loin. Toujours dans l’obscurité du petit matin, seules les lumières blafardes des phares troublées par la pollution et la poussière de la ville éclairaient ces gens de toutes sortes qui s'étaient levés tôt pour prendre le bus. Combien d’entre eux le loupe avec cette méthode d’indication aléatoire et devront se relever le lendemain matin pour espérer aller à leurs destinations? Nous, nous l’avons pris à la gare routière, ou plutôt au bord de la route ou tous les bus se regroupent avant de partir. Malgré l’heure matinale, une effervescence régnait à cet endroit. Les conducteurs parlaient fort et crachaient encore plus fort. Des jeunes passaient dans chaque bus pour vendre quelques cacahuètes pour le voyage. Des ampoules luisaient au bout de fils penduent à des échoppes d’un autre temps. Nous avions notre place assise, nous n’en bougerions pas car c’était notre ticket d’entrée pour la nature. Nous étions les seuls occidentaux, on nous dévisageait mais personne ne nous dérangeait. Le temps filait. Lentement. Moins que les kilomètres. Nous voyagions dans les vapes. Victimes du décalage horaire et d'une nuit de 2 heures, nous étions deux somnambules assis. Le seul haut-parleur qui était au-dessus de nos têtes crachait une musique népalaise autotunée suraiguë. Tout était trop fort, le son, les secousses, la dureté du siège, nous voulions dormir, nous étions semi-léthargique. Aux premières visions des sommets blancs, nous avons souris puis nous avons ressombré dans le flou. Il fallait que cela s’arrête. Nous devions arriver. Il restait encore 6 heures de route. Á partir de l'après-midi il n’était plus question de dormir, les chemins étaient trop mauvais. Plus nous avancions, plus la modernité reculait. À la fin, les bœufs tiraient les charrues dans les jardins en terrasses. Nous avions perdu 100 ans en 9 heures. Puis après une éternité le ventre du bus nous vomit et tout à coup nous étions sur le bas côté, nos sacs à nos pieds, devant un panneau “Rolwaling”. Le voyage allait vraiment débuter mais dans l'immédiat il s’agissait de grimper 400 mètres de dénivelé en deux kilomètres à peine pour trouver le premier lodge. Sans hésiter nous demandions le gîte et le couvert pour le soir. Il était 16 heures, nous avions un toit sur la tête et bientôt un dal-bhat dans le ventre. À cette heure-là c’est tout ce qui comptait.
Pendant les deux jours qui suivirent, nous nous employâmes à avancer entre deux pauses. Celles-ci avaient pour but de nous soulager les épaules et le dos. Nous goûtions au poids de nos sacs et à ses méfaits. Oh nous n'étions pas particulièrement fatigués, ni bien essoufflés. Nous étions simplement incapables de supporter ces maudits chargements plus de quarante minutes d'affilée. Mais comment font les sherpas pour porter quarante kilos avec une simple sangle sur le front ? Alors nous prenions notre temps car nous en avions. Progressivement nous quittions les champs en terrasses, les forêts denses et nous touchions peu à peu ce pays de lumières et d’air pur. À Beding, qui est presque un anagramme de “begin” , c’était le vrai début de la montagne. Nous commencions à imaginer les sommets, nous ressentions leurs premiers souffles, nous distinguions leurs premières lueurs.
Nous posions ici nos affaires pour la nuit au soir du troisième jour. À peine étions nous entrés dans le village qu’une “babouchka” comme nous l'appellerions en Sibérie, nous hélât pour nous proposer une chambre. Du moins c’est ce que nous comprîmes. Elle ramenait chez elle un panier de bouses de yaks séchées destinées à remplir son poêle et deux français destinés à remplir son auberge. Le mot remplir est ici particulièrement adapté car la chambre en question faisait environ deux mètres par deux mètres, dont deux lits de deux mètres par 90 centimètres. Ces deux lits étant remplis par deux hommes dont l’un des deux fait deux mètres de haut ainsi que par deux sacs dont le volume excède les 60 litres, combien reste-il d’espace libre ? Assez peu. À Beding, nous venions de quitter les arbres, nous étions à 3700 mètres d’altitude. À notre arrivée en début d'après-midi, comme chaque jour, les nuages bas s’engouffrant depuis le fond de la vallée nous enveloppaient. Nous allions monter au monastère accroché au flanc de la montagne deux cents mètres plus haut. Pour nous occuper, un peu, pour nous acclimater aussi, et surtout car il était temps de goûter à l’esprit bouddhiste et le contexte était parfait. Depuis, je repense souvent à cet instant où j’ai tenté de vivre un moment de “pleine conscience”. J'étais là, adossé au mur de façade du monastère. Quelques flocons virevoltaient dans les nuages, les pierres chauffées par le soleil du matin rayonnaient dans mon dos. Je n’avais pas froid emmitouflé dans ma grosse doudoune. Devant mes yeux, un cairn un peu mystique et derrière ce grand vide invisible ou dansaient les volutes cotonneuses des cumulus. Seul, complètement seul, il n’y avait que le flottement des drapeaux à prières qui brisaient le silence. Mon esprit s’évada, je ne le retins pas, étriqué, il n’alla pas loin. Lorsque je revins à moi, mon compagnon était déjà en bas, au lodge, je redescendis et je savourai. L'esprit du Tibet dont la frontière avec le Népal est juste derrière la montagne, m’effleura, mais mon crâne rasé pour l’occasion ne suffit pas pour être transpercé par bouddha.
Arriver à Na, le dernier village de cette vallée nommée Rolwaling était désormais un jeu d'enfants. Ma tête était déjà plus haute, dans les montagnes. Accablé par le poids de mon sac à dos, je marchais, assailli par le doute.. Peut-être comme tout le monde. Qu’en sais-je ? Les alpinistes ne sont pas tous de grands communicants et les récits sont plus souvent des ôdes au dépassement et à l’aventure que des recueils de peurs. Et bien moi j’avais peur. Pourquoi ? Car nous visions des sommets et allions rencontrer des altitudes inconnues pour nous. Serais-je à la hauteur? Serais-je assez solide mentalement pour supporter la rudesse des bivouacs et l'éloignement qui nous attend ? Supporterais-je de passer plusieurs jours entre cinq et six mille mètres d’altitude ? N’aurais-je pas trop peur dans les pentes abruptes des sommets que nous convoitons ? Heureusement, les doutes lorsqu’ils envahissent, se bousculent puis s’évaporent, dans l’action ou dans le renoncement. Cette peur est une fidèle amie, la compagne de l’inconnue, le signal d’alerte qu’il faut entendre, écouter mais jauger afin qu’elle vous sauve sans vous freiner. Cette alchimie, tout le monde ne la maitrise pas. Moi le premier lorsque je n’ose pas lancer le mouvement alors que j’ai déjà dépassé le point d’assurage en escalade sauf que c’est absurde puisque la corde m’offre la sécurité. C’est aussi elle qui m'empêche de partir faire une transatlantique en solitaire en voilier alors que je n’ai jamais mis les pieds sur un bateau. Dans ce cas précis elle me sauve certainement la vie car parfois elle est aussi la voie de la raison. C’est l’objet de ce livre de Gérard Guerrier que j’ai lu pendant ce voyage, nommé “ Éloge de la peur ”, qui pousse à se questionner sur cette vieille copine de route. On y rencontre des intervenants de qualité et des réflexions pertinentes mais heureusement rien qui pourrait vous en guérir. Car cette peur est aussi l'exhausteur de goût du voyage. La vie sans peur s’appelle la routine. Nous voulions en sortir.
Les trois jours suivants sont consacrés à l'ascension de notre premier objectif, le Yalung Ri, de la manière suivante. Premier jour, montée au camp de base à 5000 mètres d’altitude avec la moitié du chargement, synonyme de sacs plus légers. Là haut, nous y laissons la tente et le matériel d’alpinisme, corde, piolets, crampons et quincaillerie. Le même jour, redescente au village, puis le jour suivant, remonté avec le reste du matériel et enfin sommet puis redescente au village le troisième jour. Voilà la trame générale. Mais avant d’être une trame c’était un plan. Et avant d'être un plan c’était un projet. Le projet est souvent réfléchi à la maison avec des cartes sur la table et des rêves dans la tête. Le plan c’est l’idée précise avec laquelle on part à l’aventure. Et je n’utilise pas ce mot, "aventure” à la légère. Je l’emploi car à ce stade règne encore une part d’incertitude et c’en est l’essence même. L’aventure c’est entreprendre des choses pour lesquelles la part d’incertitude est plus grande que celle des certitudes. Lorsqu’on est enfant c’est aller camper au fond du jardin. Adolescent c’est avouer sa flamme à sa bien aimée, prudence, grande incertitude ! Puis adulte, le catalogue des aventures est immense mais attention elles sont sujettes à ce phénomène d’accoutumance. Au début, il suffit de poser son matelas sous les frondaisons du Cantal pour déclencher le frisson. Ensuite, une nuit n’est plus suffisante pour assouvir sa soif de nouveautés. Il faut partir plus loin et plus longtemps car la nouveauté et l’inconnu n’est plus sur la pas de sa porte. C’est comme cela que l’on se retrouve au Népal. Il y avait donc le plan, disais-je. Dans les interstices du plan se glissent les péripéties, qui agrémentent les souvenirs et les conversations du retour. L’aventure quant à elle s’évapore bien souvent en la vivant. On se rend compte que ce que l’on imaginait infranchissable, trop haut ou trop dur n’est finalement pas si terrible. À la fin, si l’on revient en vie et sans avoir connu de gros imprévus, cela signifie que nous sommes partis à l'aventure mais que nous ne revenons qu’avec des expériences. “ Au début on fait un voyage et à la fin c’est le voyage qui vous fait ” dit Nicolas Bouvier dans L’usage du monde. Combien sont ceux qui reviennent et peuvent légitimement dire qu’ils ont vécu la grande aventure ? Alors bien sûr, les incontournables géants, les aventuriers professionnels, les défricheurs de terra incognita, mais nous? Nous nous ne sommes que des gens normaux qui sortent de leurs douillettes demeures pour manger du riz et battre le chemin d’un bout de pays cent fois arpenté pendant un mois, rien de bien plus.
En l’espace de ces trois jours, nous avons pour la première fois dépassé l’altitude du Mont Blanc. Nos pensées nostalgiques se sont portées sur ce sommet atteint en 2018, déjà ensemble à l’époque. Nous y étions groggy par l’altitude car nous étions montés trop vite. Ici, le temps à fait son office, l’acclimatation nous protège. Pas notre téléphone satellite qui est tombé en panne le jour où nous quittions le réseau téléphonique “normal”, nous laissant sans moyen de communication pour les dix prochains jours. Nous logions chez des sherpas sympathiques mais à l’hygiène douteuse, accablés, le jeune par la maladie, le vieux par la vieillesse. Nous avons été bénis par ces mêmes sherpas et avons dormi dans leur grenier avec les souris. Nous nous sommes reposés adossés à la bâtisse dans ce solarium naturel car il semblerait que c’est pour eux une occupation majeure. Nous avons tenté d’apprendre le Népalais avec l’ancien qui ne parlait lui-même pas anglais et j’ai bien vite abdiqué devant l’inutilité. Et enfin nous avons rallié notre premier sommet donc, ce fameux Yalung Ri à 5600 mètres d’altitude, peu technique, mais dans la solitude complète. C’était notre premier bain dans le bleu du ciel.
Il fallut quitter la civilisation car c’est là que commence l’inconnu, et au fond, n’est-ce pas ce que nous recherchions? Plus question de lits et de dal bhat. Notre seul salut viendra de nous-même et de nos ressources. Nous partions de Na, ce dernier village du Rolwaling. Le soleil venait de passer les crêtes, il illuminait le fond de la vallée et réchauffait nos corps, à moins que ce ne soit la marche qui s’en chargeait. Cette journée était transitoire. Nous quittions progressivement le sentier, l’herbe, les odeurs, les couleurs. À notre gauche, loin en contrebas un grand lac grisâtre, à droite, des sommets 2000 mètres plus hauts. Au fond, un col que l’on croyait être notre objectif, et avant cela un pierrier immense. Nous l’imaginions grand mais pas au quart de ce qu’il allait représenter.
Ce premier soir, nous dormons dans une cabane dans laquelle nous choisissons de monter la tente malgré l’heure encore peu avancée de l'après- midi. En montagne comme dans la vie, l’herbe n’est pas plus verte ailleurs, il faut savoir saisir les opportunités et cette cabane en est une. Elle nous offre à dormir sur un sol plat, à l’abri du vent, et permet au thermomètre de ne descendre qu’assez peu en dessous de zéro. Et puis la fin d’après midi n’est pas complètement dédiée à l’oisiveté. Il faut encore aller chercher la glace bien plus bas, la piler et la faire fondre afin d’avoir de l’eau pour ce soir et pour le lendemain. L’eau courante, cette invention. Puis le soleil se couche, les lumières sont fabuleuses, quelques nuages dansent devant nous à seule fin de nous divertir, c’est évident. Progressivement la lumière baisse, les chutes de pierres diminuent sur le versant d’en face et le silence augmente jusqu’à devenir complet. Il est l’heure de dormir.
Nous partions ce jour comme des marcheurs, c'eût été plus utile de se sentir marin. Un océan de pierre nous attendait. Des vagues de plusieurs mètres de haut, parfois des ondulations légères, mais pas un souffle de vent, tout était figé. Il n’y avait que nous qui bougions dans ce paysage, mais à vitesse si réduite que s’en était imperceptible. Il s’agissait d’un glacier, mais noir. On imagine aisément une mer blanche, noire, verte, bleue ou que sais-je encore. Un glacier, doit être blanc. Sauf quand il est recouvert de rocailles. C’est que nous étions dans sa partie basse, il avait eu le temps de récolter et de charrier tout ce que la montagne a pu déverser dessus. Cela causera sa fin car une fois noir il enmagasine la chaleur et fond plus vite. En regardant la carte, nous imaginions filer à toute berzingue sur une belle calotte blanche, éventuellement faire quelques détours pour éviter les crevasses, et bien non. Toute la journée, et pour parcourir seulement dix kilomètres, nous bartassions, l'œil à l'affût du prochain cairn, seul balisage dans l’immensité. Comme à notre habitude nous avancions par fractions. Quarante cinq minutes de marche puis une pause. Il ne la fallait pas trop longue car le mouvement du glacier nous aurait ramené en bas, quoique cela aurait pris mille ans. Et puis, “comme les emmerdes, ça vole toujours en escadrilles” , il fallut que mon corps décide que ce soit le jour pour uriner du sang. Le matin, un petit côte de Provence léger. A midi, un bon St-Emilion. Le soir, boudin noir. Ce n’était pas le menu mais le nuancier de couleur de la pause pipi. Je portais ma petite inquiétude, d’autant que rappelons le, le téléphone satellite avait rendu l’âme. Nous étions ainsi à deux ou trois jours de marche du premier moyen de secours ce qui suffisait pour y rester. Néanmoins j’avais déjà vécu cette expérience et je savais qu’en m’hydratant, normalement, cela passerait. Et c’est passé deux ou trois jours après. Je n’osais rien dire à mon compagnon. Chacun son fardeau.
Mon compagnon justement, cela fait presque deux semaines que vous le côtoyez et vous ne le connaissez toujours pas. Laissez-moi vous le présenter. Bibou pour tout le monde, Benjamin pour les autres. Le physique d’un dieu grec s'il ne lui manquait pas vingt centimètres de haut. Les épaules larges, les biceps ronds, abdominaux apparents. Brun du crin. La peau mat. Bronzé au bout d’une semaine, on eût dit un panda, mais inversé. La trace des lunettes de soleil lui faisait un rond blanc sur un peau noir, cela faisait baroudeur comique. Le pas sûr, l’endurance infinie, définition du sherpa. Et puis, il faut voir ses expressions faciales, la lecture y est facile. L’œil espiègle et le sourire coquin du gamin qu’il est résté du haut de ses trente sept ans. Il ne cite pas Nietzsche mais il lit très bien les blagues carambar, atout plus essentiel en communauté. Carambar dont je vous reparlerai plus tard, rappelez le moi si j'oublie ! Toujours prompt à la rigolade, il n'est pas le dernier à la déclencher et je garde en souvenir ce moment délicieux lorsqu’à Kathmandou, comme souvent dans la rue, un homme approche en jouant de la flûte afin de nous vendre ledit objet. Celui-ci, confiant, lance pour engager la conversation : “You like?”. Et mon Bibou qui le plus sérieusement du monde mais d’une promptitude qui confine au réflexe lui répond les yeux dans les yeux: “No I hate !”. Nous n’avons pas acheté de flûte mais fort estomaqué je ne pu m'empêcher de rire. Alors bien sûr je pourrais continuer à vous parler de lui pendant des heures car un mois ensemble permet, je crois, de mieux se connaître encore, mais je m'arrêterais là car ce voyage nous l’avons vécu à deux et dans une parfaite harmonie, de celle qui néglige les individualités pour promouvoir le duo. La cordée de deux. Laurel et Hardy comme nous appellent certains copains. Le petit costaud et le grand dégingandé. L’amitié par delà les différences.
Avec tout cela la journée se termine et je ne sais plus très bien si ces formes incongrues de champignons sont le fruit de mon imagination ou la réalité. D'énormes pierres sont posées sur de fins troncs de glace. Cela crée ces formes de cèpes grotesques à la taille démesurée, près de 3 mètres de haut parfois, et à la fragilité que l’on imagine. Là encore c’est une histoire de température pour ces végétaux immémoriaux. Quelques degrés supplémentaires et s’en est fini de ces originalités.
Nous posons la tente, enfin, au pied du col toujours sur l’immense glacier et déjà à 16 heures nous sommes à l’ombre. C’est une combe à froid. Un frigo en d’autres termes. La nuit il fera certainement -15° mais nous dormirons, harassés.
Le jour suivant est plus une veille qu’un lendemain. C’est le lendemain d’une longue journée mais c’est surtout la veille du sommet. L'étape est courte, nous atteignons rapidement le col, le fameux Tashi-La-Pass à 5700 mètres d’altitude. Notre porte de sortie du Rolwaling, la seule. Autrement il aurait fallu rebrousser chemin et nous n’aimons pas cela. Par delà le col, le Khumbu, la vallée de l’Everest, la civilisation, le tourisme. Nous devons dormir au col, sur une petite plateforme de pierre car demain nous visons le sommet du Pachermo à 6279 mètres d’altitude. Nous percevons déjà le début de l’ascension mais nous ne savons pas encore s'il y a des cordes fixes, si la neige est de bonne qualité ou si c’est “bleu”, c'est-à-dire en glace dur comme du verre et donc angoissant lorsque les pointes avants des crampons ne s’enfoncent que de quelques millimètres. Alors nous nous couchons car il y a du vent, car il est froid et que notre seul refuge est la tente, mieux encore le sac de couchage. Ce pauvre objet de 2 mètres de long garni de plumes constitue le seul endroit confortable où nous pouvons nous trouver. Aussi mince que cela puisse paraître, il peut nous sauver la vie ou simplement la rendre acceptablement tiède. Il suffisait donc de cela pour trouver le confort. Ikea n’avait rien compris, une toile et des plumes pour tout salon. Nous qui aménageons nos intérieurs en prenant garde à conserver un flux feng-shui dans une ambiance scandinave, il n’y a qu'à y opposer deux sacs de couchages confort -10° aux couleurs criardes, un réchaud fumant le tout dans une tente bien tendue pour obtenir le confort. La condition est que le dehors soit grandiose mais froid. C’est vrai, qui voudrait s’enfouir dans un sac de couchage dans la Beauce tiède et humide? Le problème vient finalement plus du dehors que du dedans. Mieux vaut une bicoque au paradis qu’un château en enfer.
Nous jouissions donc de notre suite royale de 3 mètres carrés en nous occupant comme le font les gens qui attendent, en ne faisant rien ce qui est déjà faire quelque chose. La lecture était pénible car nos mains gelaient rapidement. Manger était agréable mais il n’est pas viable de le faire de 16 heures à 22 heures. Somnoler en silence était le plus recommandé. Puis nous avons enfin dîné et savouré notre dernier carambar ce qui m’amène à vous en reparler. Ou plutôt à glisser ici un coup de gueule de poltron car absolument certain que jamais personne de chez Carambar ne lira ce texte. L’objet de cette réprimande porte plus sur la blague que sur le bonbon en lui-même. Peut-être faut-il consommer cette confiserie quinze jours durant et y chercher à chaque fois un peu d’humour dans ses emballages pour s’en rendre compte, mais que diable, changez de rédacteurs! Ce n’est pas dieu possible ! L’employé préposé à la rédaction n’est resté que trois jours en poste dont deux en arrêt maladie ou je ne m’y connais pas. Il y a environ cinq blagues en tout est pour tout, et d’une qualité plus que discutable. Mais à quoi bon critiquer sans proposer, alors voici mes conseils à cette entreprise qui finira par battre de l’aile si rien n’est fait. D’abord, créer une collection “adulte”, afin de pouvoir s’extraire définitivement des blagues du type : “Quel métier les chiens peuvent-ils exercer ? Electrichien !” Deuxième et dernier conseil : embaucher Bigard puisque Coluche n’est plus. Pas que je mette Bigard au niveau de Coluche mais… et puis je n’ai pas besoin de me justifier ! Merde ! Voilà, de quoi donner une nouvelle dynamique à une entreprise qui se prive d’une certaine clientèle.
Il est 5 heures du matin et le réveil sonne comme un soulagement. Les quelques rêves que j’ai fait en somnolant se déroulaient tous sur un voilier au-delà des 50èmes hurlants. Le vent à fait battre la toile toute la nuit, nous n’avons pas vraiment dormi. Les chaussures sont dures comme du bois mais il faut bien les mettre. Il fait -10°. Se dépêcher de s’agiter car le mouvement c’est la chaleur. Rapidement après l'absorption de la tsampa fade et tiède nous montons sur les premières pentes débonnaires du Pachermo. Nous avons le plaisir de trouver des cordes fixes neuves dès que la pente s’élève un peu. Ce sommet est assez peu parcouru du fait de son éloignement relatif car, d’un côté comme de l’autre, il faut entre deux et quatre jours d’autonomie pour l’atteindre. Malgré cela, une expédition commerciale à dû passer par là plus tôt dans l’automne pour que des cordes fixes soient installées. En effet, pour sécuriser leurs clients, les guides et les sherpas installent ces lignes de vie et elles restent ensuite sur la montagne. Alors nous grimpons, essoufflés comme après un sprint infernal et pourtant à une allure d’escargot. Le vent est cinglant, nous estimons la température ressentie aux alentours des -20°. J’ai l’onglet aux mains, j’aimerais faire quelques photos mais je m’abstiens le plus souvent car il faudrait enlever les gants. Tous mes vêtements sont sur moi (à part ma Gore-Tex), y compris ma grosse doudoune et j’ai juste chaud dans l’effort. Parfois, le fil de l'arête nous fait passer côté soleil et à l’abri du vent. Nous gagnons instantanément 20°. C’est le confort. Ce même soleil que nous avons vu émerger de la ligne d’horizon constitué des plus hautes montagnes du monde dans un jeu flamboyant de couleurs célestes. Comment ne pas être ému. À quelques endroits nous sommes soulagés de trouver ces fameuses cordes, surtout lorsqu’il s’agit de franchir des petits ressauts de glace au-dessus de crevasses béantes. Cela arrive deux ou trois fois. Puis nous voila au sommet. Cela parait un peu soudain mais c’est la réalité. Nous avançons et d’un coup ce n’est plus possible, cela signifie que c’est terminé. L’alpiniste ne connaît que deux types de déplacement, l’ascension ou la descente. Nous tentons une accolade ridicule comme deux bibendums engoncés. Nous sommes heureux et pour la première fois nous voyons les sommets que nous ne savons pas encore nommer: L’Everest, le Lhotse, le Makalu, l’Ama Dablam, la liste est infinie. Et pour ceux qui se demandent ce que font les gens au sommet, la réponse est claire : rien. Car la haut il n’y a plus rien à faire qu’à redescendre et commencer à rêver au prochain. Alors nous ne dérogeons pas, nous ne restons pas. Quoique quelques mètres en dessous il y a une plateforme à l’abri du vent, nous en profitons pour nous réchauffer un peu les pieds et les mains, pour boire notre dernière lampé de génépi aussi, pour se congratuler une dernière fois et enfin pour se rappeler qu’il s’agit de redescendre, en vie.
Épilogue, l’Everest
Nous avons fini par redescendre, par nous perdre dans l’immense pierrier de l’autre côté du col et enfin par retrouver la civilisation. Petit à petit. Puis nous sommes arrivés deux jours plus tard à la capitale des sherpas, Namche Bazar, où nous avons bu de mauvaises bières dans l’irish bar le plus haut du monde et mangé de mauvaises pizzas à droite à gauche. Puis nous sommes repartis sur le trek du Gokyo Ri où nous avons vu un lac sublime, joyaux entre les montagnes. Nous avons de nouveau forcé un col à plus de 5000 mètres ce qui est plutôt banal au Népal. Et enfin nous sommes arrivés à Gorak Shep, la ville la plus proche du camp de base de l’Everest. De là, après une mauvaise nuit, nous sommes montés au sommet du Kala Pattar, la taupinière qui fait face à l’Everest. Je regrette que Bibou fut malade à cet instant, ce qui le priva de profiter du spectacle car pour moi ce fut quelque chose d’unique. Se trouver là, devant le toit du monde quelques 3500 mètres en dessous de la pyramide sommitale du mont Everest m’a fait quelque chose. Là haut et malgré le beau temps, des filaments de nuages s’accrochaient au sommet. C’était l’illustration du vent, le symbole de la dureté et de l'inaccessibilité. Le finistère ultime. Le point le plus haut du globe terrestre. Comme devant toutes les extrémités de la planète j’étais rêveur, stupéfait, pantois. Cela provoquait en moi quelque chose de l’ordre de l’intangible mais j’étais rassuré, je savais que je ne voulais pas y aller. Que partir à l'assaut de ce sommet, outre les aspects financiers et logistiques, ne me faisait pas tellement rêver. Que la mort rôde bien trop près de ceux qui fréquentent Chomo Lungma. Et je repense à ces légendes. Les deux premiers “summiters” évidemment, Hillary et Tensing Norgay. Mais aussi aux français menés par Pierre Mazaud en 78. Combien devaient être dures ces premières. Dans quel inconnu se lançaient ces hommes à l'assaut de cet ogre immense. Et pour quoi ? Pour l’honneur. Par amour de l’aventure, la vraie celle-ci. Pour leurs pays parfois. Et pour satisfaire ce besoin humain de gravir les montagnes aussi.
“Pourquoi tenter de gravir l’Everest ?” a un jour demandé un journaliste à George Mallory, le premier homme à peut-être avoir atteint le sommet. La réponse est parfaite: “ Parce qu’il est là”.
Fin